Il y a quatre ans, votre mère a emménagé en EHPAD mais du fait de l’aggravation de sa maladie d’Alzheimer, l’établissement a proposé de la placer dans son unité de vie protégée (UVP). Cependant, vous trouvez que depuis son installation elle est désorientée, moins épanouie qu’auparavant.
Est-ce l’effet du déménagement ? Vous vous demandez quand même si cette UVP est bien adaptée à ses besoins. Cet article fait le point sur l’intérêt et les limites des UVP en EHPAD pour les personnes âgées atteintes d’Alzheimer.
Les UVP en EHPAD : un cadre sécurisé et rassurant
Les unités de vie protégée ont un cahier des charges qui répond aux besoins des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. N’accueillant pas plus de 10 à 20 patients, elles permettent une prise en charge complète et sûre.
Un hébergement protecteur contre les fugues et les accidents
Le comportement de votre mère comme des autres résidents de l’UVP peut mettre sa vie en danger. L’errance ou la désorientation sont fréquentes chez les personnes atteintes de troubles cognitifs. Pour éviter les fugues dangereuses, les UVP disposent de portes sécurisées et d’un suivi constant des soignants. Leur architecture est pensée non pas comme une prison, mais comme un espace permettant à la fois une liberté de déambulation et une sécurité par le contrôle des accès.
Un lieu pensé pour limiter les troubles anxieux
La maladie d’Alzheimer provoque des moments de grande anxiété chez les personnes atteintes de ce type de pathologie. Elles ont l’impression d’être perdues, de ne pas reconnaître leur environnement, elles peuvent être prises de crises de panique. Tout est organisé dans les unités de vie protégée pour réduire ces moments de stress chez les résidents :
–Repères visuels et couleurs adaptées pour favoriser l’orientation ;
–Absence de longs couloirs pour limiter l’impression de perte de repères ;
-Espaces de déambulation protégés, permettant aux patients de marcher sans risque ;
-Un personnel formé pour répondre à ces angoisses. Le rôle de l’aide-soignante en unité Alzheimer est fondamental. Elle connaît les bonnes pratiques pour apaiser l’anxiété, éviter les crises et stimuler les patients de manière adaptée.
Des thérapies adaptées à la maladie d’Alzheimer
Les maladies neurodégénératives nécessitent une prise en charge multimodale, mélangeant des thérapies conventionnelles à des activités plus expérimentales. C’est ce que l’on retrouve au sein des UVP.
Des soins médicaux pour traiter les symptômes de la maladie
Les résidents d’une unité Alzheimer bénéficient de traitements prescrits et suivis par des médecins et des praticiens présents dans l’unité.
Si certains médicaments permettent, sous la supervision des médecins coordonnateurs, de réduire les troubles comportementaux, et de traiter des pathologies physiologiques, d’autres intervenants accompagnent également les patients au quotidien :
-Des psychologues, pour l’accompagnement émotionnel ;
-Des ergothérapeutes, kinésithérapeutes et psychomotriciens, pour maintenir l’autonomie des résidents atteints ;
-Des infirmiers ;
-Des assistants de soins en gérontologie ;
-Le ratio personnel/patients en unité Alzheimer est plus élevé qu’en EHPAD : c’est la garantie d’un accompagnement complet et constant des résidents. Il s’agit ainsi d’aider les malades à lutter contre la progression de la maladie et à conserver un tonus nécessaire à leur autonomie.
Des activités douces et stimulantes pour mieux vivre en UVP
Les soins médicaux et paramédicaux sont complétés par de nombreuses activités destinées à aider les résidents d’unité protégée Alzheimer à mieux gérer et supporter les troubles comportementaux. On trouve ainsi, selon les différentes UVP en EHPAD :
-De la musicothérapie pour calmer l’anxiété ;
-De la zoothérapie qui permet de conserver et tisser un lien affectif ;
-De l’art-thérapie et des activités sensorielles adaptées aux stades avancés de la maladie, etc.
Grâce à ces méthodes, les troubles comportementaux tels que l’agitation ou l’agressivité peuvent être réduits sans surmédicalisation, améliorant ainsi le bien-être général des malades.
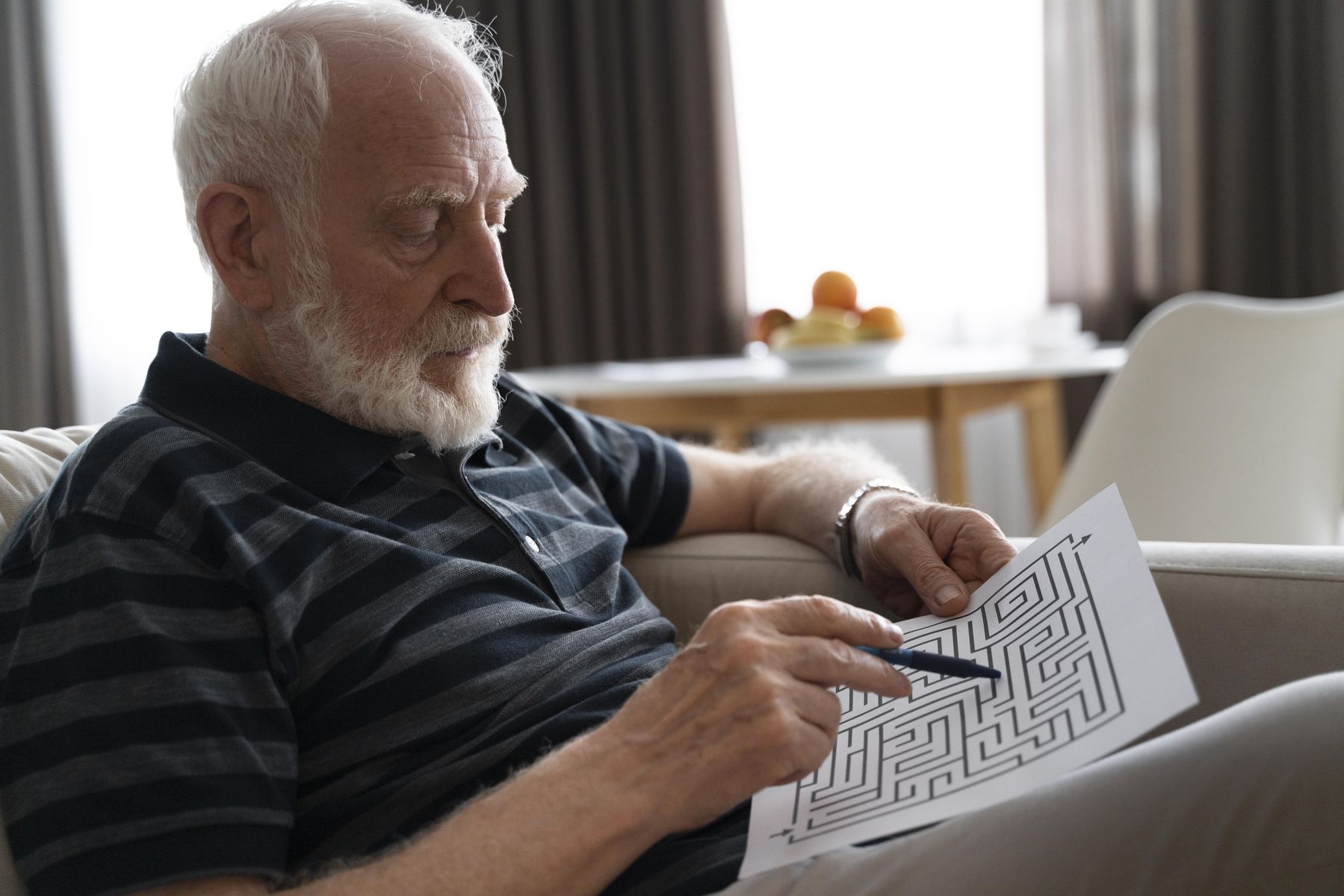
Contre la maladie, la stimulation cognitive
La maladie d’Alzheimer affecte les capacités cognitives. Bien qu’aucune thérapie ne parvienne actuellement à enrayer ces effets, la pratique d’activités tournées vers la mobilisation de celles-ci permet de :
-Freiner la détérioration cognitive,
-Offrir aux résidents un mieux-être psychologique.
Les unités de vie Alzheimer proposent ainsi de nombreuses activités de stimulation pour ralentir la perte des capacités cognitives. Ce sont, entre autres :
-Des ateliers mémoire, adaptés au stade de la maladie ;
-Des jeux et exercices cognitifs favorisant la concentration ;
-Des activités physiques douces, pour maintenir la motricité.
Le maintien du lien social chez les résidents en UVP
Les troubles cognitifs et les troubles modérés ou sévères du comportement ont pour effet d’isoler les malades. C’est aussi ce contre quoi l’unité de vie protégée permet de lutter. Les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer conservent une vie sociale grâce à :
-Des espaces de vie adaptés, favorisant les échanges ;
-Des animations collectives, encadrées par des animateurs spécialisés ;
-La participation active des familles à l’accompagnement de leur proche. Des réunions d’information sur l’évolution de la maladie ainsi qu’un suivi régulier avec l’équipe soignante sont organisés.
Des approches hétérogènes selon les établissements
Le nombre d’unités de vie protégées en EHPAD a connu une forte croissance. Aujourd’hui, on en trouve dans plus de la moitié des 7500 EHPAD de France. Ce développement rapide a eu pour conséquence un manque de standardisation des prises en charge.
Chaque unité Alzheimer fonctionne différemment, et propose des activités et des thérapies propres. Certains établissements privilégient une prise en charge très axée sur la médicalisation, au détriment de l’accompagnement humain et relationnel. Il est donc nécessaire de s’informer très précisément du type de prise en charge et de la qualité de l’équipe avant d’y faire entrer son parent
Un accès encore difficile aux UVP
Malgré le développement des UVP, le nombre de places proposées dans ces unités protégées reste encore insuffisant. Alors que plus de 200 000 résidents d’EHPAD souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, seuls 30 000 à 40 000 (INSEE 2024) sont actuellement hébergés en UVP. Les listes d’attente sont souvent longues, et selon la région, trouver une place peut être un véritable défi pour les familles.
Les critères d’admission en unité Alzheimer sont parfois très stricts, ce qui peut allonger les délais d’accès : par exemple, les troubles modérés du comportement peuvent ne pas être jugés comme nécessitant une UVP. Enfin, le coût d’un hébergement en unité Alzheimer est souvent plus important qu’en EHPAD. Cela est dû à l’accompagnement des résidents très encadré par les soignants, les aides-soignants et les intervenants. Le reste à charge peut ainsi être un frein pour de nombreuses familles.
Sans conteste, l’unité de vie protégée est tout à fait adaptée aux besoins des malades d’Alzheimer. En règle générale, votre mère pourra y mener une existence moins dégradée que dans son EHPAD, grâce à l’ensemble des soins et activités qui y sont proposés. De même, vous n’aurez plus à craindre une disparition par fugue ou un accident : tout est fait pour protéger la vie des résidents. Les inconvénients réels, comme le coût, la disparité des prises en charge ou même le principe de l’enfermement, peuvent être atténués mais ne rendent pas moins légitimes les UVP.






Laissez un commentaire